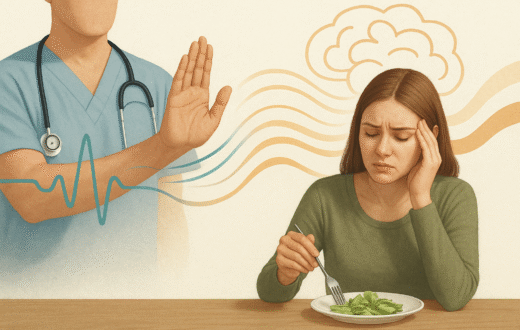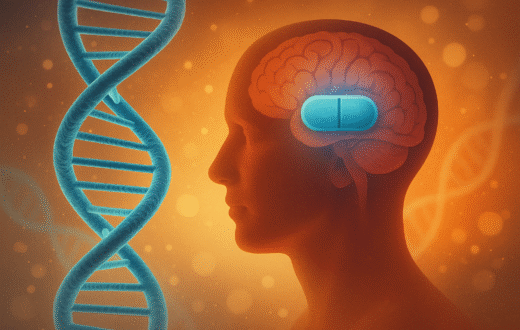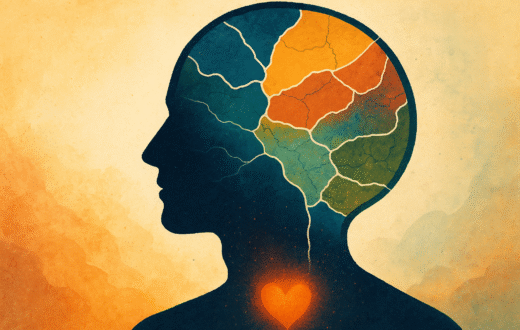Le traitement des émotions complexes chez les adultes autistes

La reconnaissance précise des émotions est essentielle pour des interactions sociales réussies.
Les chercheurs distinguent généralement deux catégories : les émotions de base (colère, peur, dégoût, joie, tristesse, surprise) et les émotions complexes, qui résultent de la combinaison des émotions fondamentales avec les processus cognitifs, ainsi que des influences sociales et culturelles.
Les études montrent que les adultes autistes peuvent rencontrer des difficultés à identifier certaines émotions de base. Dans des tests de laboratoire, par exemple, ils interprètent parfois les expressions faciales avec moins de précision que les adultes neurotypiques.
Cependant, des recherches récentes indiquent que leurs compétences dans des situations de la vie réelle sont probablement sous-estimées. Les indices contextuels – tels que la posture corporelle, les gestes ou l’environnement – semblent améliorer leur reconnaissance émotionnelle. Les adultes autistes s’appuieraient même davantage sur ces indices que les adultes neurotypiques.
Pour vérifier cette hypothèse, Kline et Blumberg (2025) ont comparé des jeunes adultes autistes avec des jeunes adultes sans trouble neurologique, psychiatrique ou développemental. Les participants ont observé des émotions sous trois formes :
- Le visage seul exprimant une émotion.
- Le visage accompagné d’une posture corporelle complète.
- Le visage et le corps replacés dans un contexte significatif (par exemple, un sourire avec un geste « pouce levé » sur une plage ensoleillée).
Les résultats ont montré que les adultes autistes étaient plus précis lorsque des indices contextuels et environnementaux étaient disponibles, tandis que les adultes neurotypiques obtenaient des résultats constants dans toutes les conditions.
Ces résultats suggèrent que les adultes autistes utilisent une approche différente pour traiter les émotions, en accordant une plus grande importance au contexte. Lorsqu’ils disposent de suffisamment d’indices, ils identifient les émotions aussi bien que les neurotypiques.
Les auteurs soulignent que la recherche s’est trop souvent concentrée sur les déficits au lieu d’examiner les différences. Les tests basés uniquement sur la reconnaissance faciale risquent de sous-estimer les véritables capacités émotionnelles des adultes autistes.
Mieux comprendre ces différences permettrait de valoriser d’autres formes d’intelligence émotionnelle. Un traitement plus lent et basé sur le contexte peut même être avantageux dans certaines situations.
Ainsi, les interventions en communication sociale gagneraient à intégrer davantage d’indices contextuels et non faciaux, afin de permettre aux adultes autistes d’exploiter pleinement leurs atouts dans la compréhension des émotions.