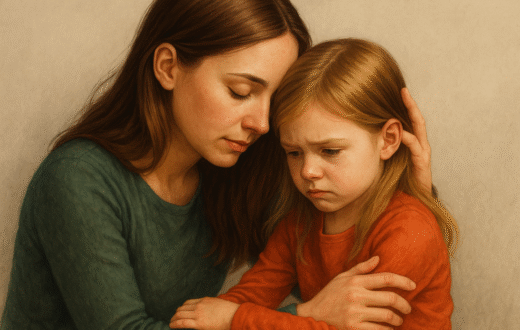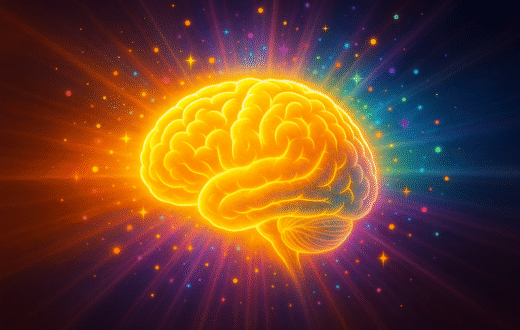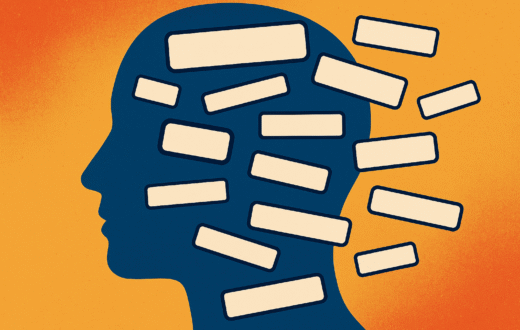L’autisme et le mythe de l’empathie : ce que dit réellement la science
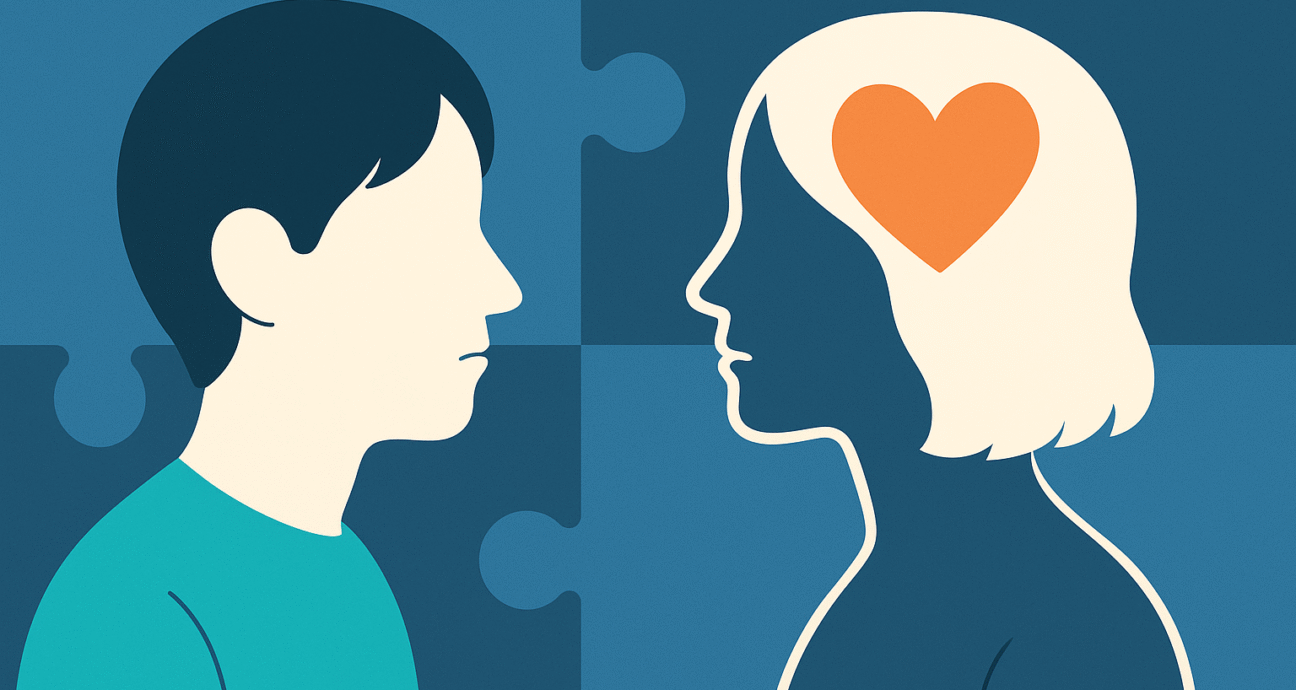
Depuis des décennies, on suppose que les personnes autistes manquent d’empathie. Cette idée a façonné les critères diagnostiques, influencé les représentations dans les médias et orienté les pratiques éducatives et professionnelles. Pourtant, une nouvelle méta-analyse remet sérieusement en question cette croyance.
En examinant 226 études impliquant plus de 57 000 personnes, les chercheurs révèlent une réalité bien plus nuancée.
Résultats principaux
- Des profils d’empathie différents : Les personnes autistes éprouvent plus de difficultés dans l’empathie cognitive (comprendre les pensées et émotions d’autrui), tandis que les différences en empathie affective (ressentir les émotions des autres) sont faibles.
- Les meilleures études montrent peu de différences : En se basant uniquement sur des travaux méthodologiquement solides, même ces écarts mineurs disparaissent.
- Un problème de mesure : Des outils comme le Questionnaire d’Empathie (EQ) exagèrent les différences car ils mélangent empathie et compétences sociales. Des instruments multidimensionnels, tels que l’Indice de Réactivité Interpersonnelle, offrent une image plus équilibrée.
Pourquoi c’est important
- La moitié des recherches souffre de faiblesses méthodologiques.
- Un biais de publication privilégie les résultats soulignant les différences.
- Les personnes autistes montrent une variabilité plus large : certaines obtiennent des scores plus faibles, d’autres comparables, et certaines encore plus élevés que la moyenne.
Conclusion
L’idée selon laquelle l’autisme serait défini par un déficit d’empathie est davantage un mythe qu’une réalité scientifique. Les professionnels et la société doivent actualiser leur vision de l’autisme, dépasser les stéréotypes déshumanisants et reconnaître la diversité des expériences vécues par les personnes autistes.