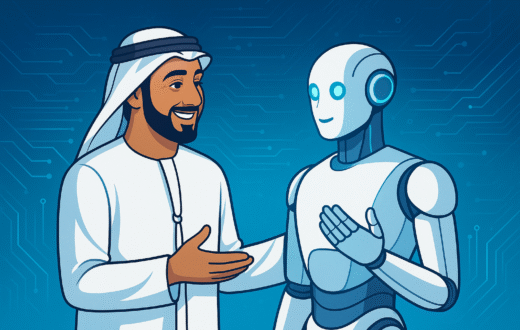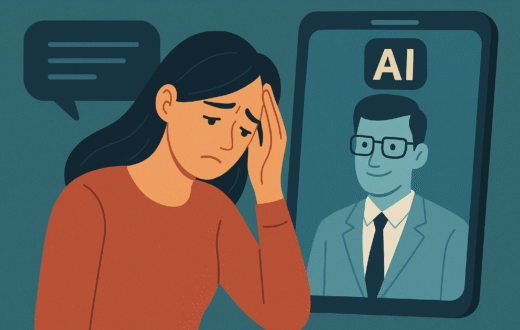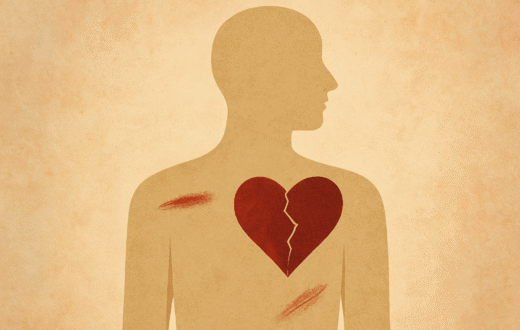Addiction et traumatisme : un lien complexe, mais non inévitable
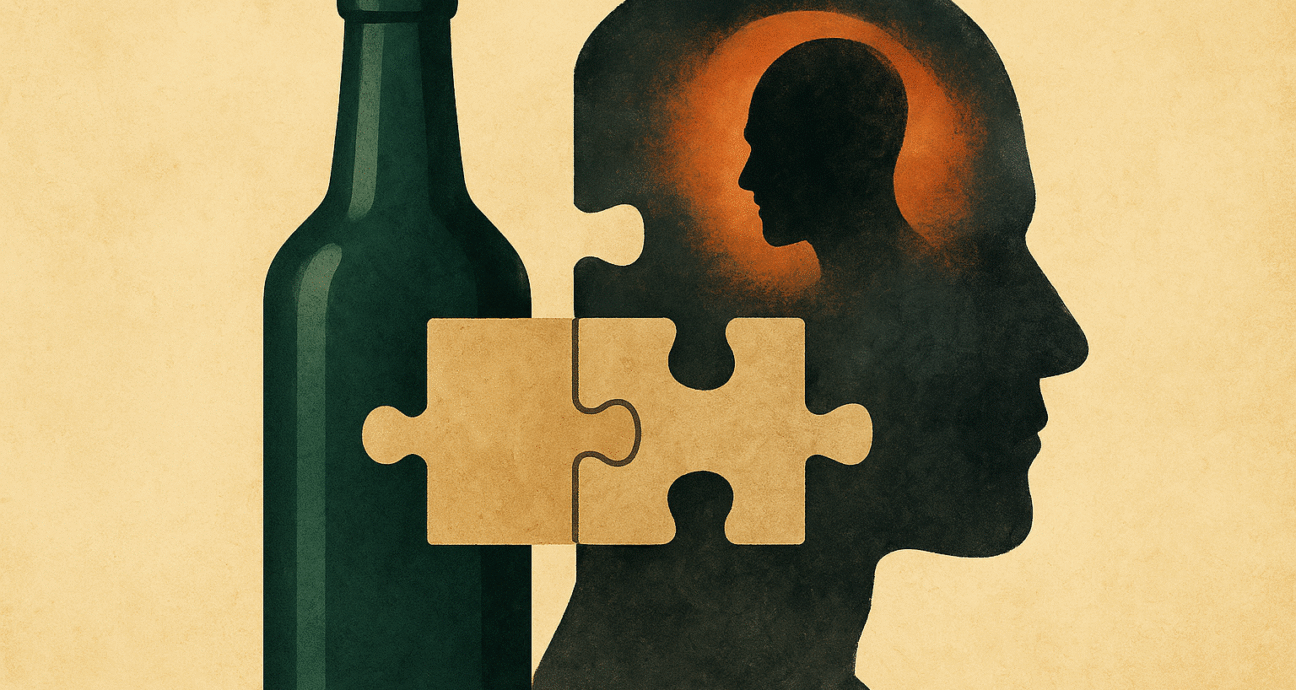
Dans le milieu clinique, une idée revient fréquemment : l’addiction serait avant tout une réponse au traumatisme. Selon cette perspective, qu’il s’agisse d’alcool, d’opioïdes, de sexualité compulsive ou d’autres comportements, la cause profonde résiderait dans un vécu traumatique—souvent remontant à la petite enfance—et le comportement addictif servirait à « s’auto-médicamenter ». Bien que séduisante par sa simplicité, cette vision occulte une réalité beaucoup plus nuancée.
Il est indéniable que de nombreuses personnes dépendantes ont vécu des traumatismes, et que reconnaître ce passé peut être une étape essentielle du traitement psychothérapeutique. De plus, les soins devraient être sensibles aux traumatismes, c’est-à-dire tenir compte de leurs effets parfois subtils mais durables. Cependant, l’idée que presque toutes les addictions découlent du traumatisme—et que leur traitement se confond donc avec celui de ce traumatisme—n’est pas étayée par l’ensemble des données scientifiques disponibles.
Cette conception a gagné en popularité grâce à des auteurs comme Gabor Maté, dont l’ouvrage In the Realm of Hungry Ghosts m’avait moi-même convaincu à l’époque que l’addiction prend presque toujours racine dans des blessures émotionnelles précoces, qu’elles proviennent d’abus, de négligence ou de carences développementales plus subtiles. Mais si cette théorie séduit, sa validation scientifique demeure limitée.
Les recherches sur les expériences négatives de l’enfance (ACEs) montrent bien un lien entre un score ACE élevé et la probabilité accrue de comportements addictifs. Une méta-analyse publiée dans The Lancet indique que les personnes rapportant quatre ACE ou plus ont un risque six fois plus élevé de consommation problématique d’alcool et dix fois plus élevé pour les drogues illicites.
Cependant, ces chiffres doivent être interprétés avec prudence. D’abord, la corrélation n’implique pas la causalité : les ACE vont souvent de pair avec des désavantages socio-économiques, eux-mêmes liés à l’addiction. Ensuite, l’intensité du lien varie selon la substance—le tabac, par exemple, montre une augmentation moindre (trois fois)—ce qui suggère un ensemble de facteurs imbriqués plutôt qu’une cause unique centrée sur le traumatisme.
Une conclusion plus équilibrée serait : un passé marqué par des ACE est associé à un risque plus élevé d’addiction, mais plusieurs mécanismes, y compris le traumatisme, interviennent, et leurs interactions restent partiellement comprises.
Cette précision est importante, car supposer un lien direct pour chaque patient comporte le risque d’erreurs cliniques et d’une stigmatisation implicite. Beaucoup de personnes dépendantes n’ont pas vécu de traumatisme, et inversement. Aborder la relation thérapeutique en partant du principe que le traumatisme doit exister, c’est passer à côté de la singularité de chaque parcours et de la complexité multifactorielle de l’addiction.
En somme, l’addiction nous invite à accepter l’incertitude, à éviter les simplifications excessives et à respecter l’histoire unique de chaque individu.