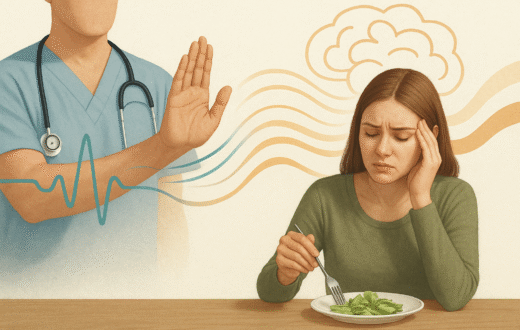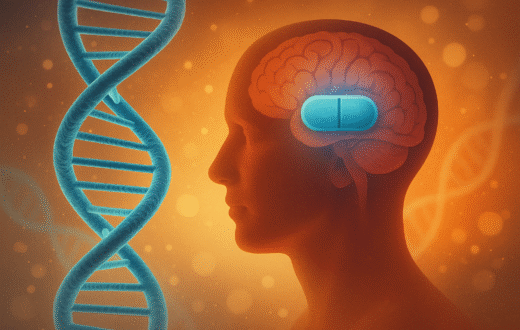Le danger caché de la “culture du traumatisme”
Ces dernières années, la sensibilisation au traumatisme psychologique a pris une ampleur considérable. En soi, c’est une avancée positive pour la santé mentale. Mais ce mouvement bien intentionné a engendré un effet secondaire inattendu : de plus en plus de personnes interprètent toute souffrance émotionnelle comme un traumatisme.
Le mot traumatisme, autrefois réservé au vocabulaire clinique, est désormais utilisé pour qualifier presque toute difficulté : disputes familiales, stress au travail, ruptures sentimentales… Cette généralisation peut amener à penser qu’une douleur passagère est une blessure profonde nécessitant un traitement lourd, alors qu’il s’agit parfois d’une réaction normale, temporaire, qui peut se résoudre par des moyens plus simples.
Un flot de désinformation
Réseaux sociaux, blogs et vidéos ont diffusé des idées simplifiées voire erronées, comme celle de “vivre en mode survie” de façon permanente. En réalité, la plupart des gens traversent plutôt une activation temporaire face au stress. Ce discours peut conduire à croire que l’on est irrémédiablement “endommagé”, alors qu’il s’agit parfois d’un processus de guérison déjà en cours ou simplement d’une étape douloureuse mais normale de la vie.
L’analogie est parlante : avoir eu la varicelle laisse une trace dans le système immunitaire, mais cela ne signifie pas que la maladie est toujours active. De même, une expérience difficile peut marquer une personne sans entraîner un dysfonctionnement permanent.
Ce qui se passe réellement dans le cerveau
La souffrance émotionnelle se situe sur un spectre :
- Un signal, pas une pathologie : comme la douleur physique, elle indique qu’une attention est nécessaire.
- Un besoin de traitement actif : le cerveau conserve les blessures non résolues jusqu’à ce qu’il comprenne ce qui s’est passé et comment mieux réagir à l’avenir.
- Le traumatisme véritable : il reprogramme le système nerveux, perturbant la perception de sécurité même dans des contextes sûrs.
Appliquer une thérapie du traumatisme à une simple peine de cœur revient à opérer une ecchymose : une démarche bien intentionnée mais inutile, voire nuisible.
Le risque des étiquettes
Tout qualifier de traumatisme risque d’affaiblir la résilience naturelle. Une personne en deuil après un divorce pourrait passer des années en thérapie spécialisée alors qu’elle a surtout besoin d’accompagnement pour traverser sa tristesse et rebâtir sa confiance.
Retrouver clarté et autonomie
Distinguer entre douleur émotionnelle normale et traumatisme réel nous aide à passer du rôle de victime à celui d’acteur de notre propre guérison. Comprendre que l’on n’est pas “cassé” mais simplement humain face à l’adversité change profondément la manière d’aborder sa santé mentale.
Toutes les blessures ne sont pas des traumatismes, et toutes les cicatrices n’exigent pas d’être “réparées”. Parfois, la guérison commence lorsque l’on croit en sa capacité à surmonter l’épreuve—une fois que l’on a identifié ce dont on se rétablit réellement.